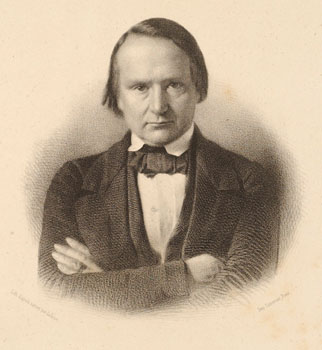Un coup d'aile de papillon peut déclencher l'orage aux antipodes, disait-on. La disparition de la moitié des papillons suffit, déjà, à bouleverser nos écosystèmes, ce dont la majorité des humains "se fout" ! Abeilles et papillons concourent pourtant à la reproduction des plantes et, indirectement, à notre alimentation comme à celle, directement cette fois, des oiseaux. C'est, tout simplement de l'équilibre du vivant qu'il s'agit.
Ecologue
Butiner est une activité de moins en moins possible pour les papillons. Conséquence : les populations sont en déclin, comme le montre un rapport de l'Agence européenne de l'environnement publié mardi 23 juillet. La plus grande crise qu'on ait vue de mémoire de papillon.

Papillon "azuré du serpolet", une espèce en danger (JCP&CO).
D’après un nouveau rapport de l’Agence européenne de l’environnement, publié mardi 23 juillet, le nombre de papillons dans les prairies d’Europe a diminué de moitié en vingt ans.
Ce résultat n’est pas anodin, car ces espèces sont un pan important
des écosystèmes. Les papillons contribuent par exemple à la reproduction
des plantes sauvages, en butinant et en transportant le pollen d’une
fleur à l’autre, et ils sont la nourriture d’un grand nombre d’oiseaux.
Mais surtout, ce résultat traduit une tendance de fond préoccupante pour
la biodiversité en Europe.
Des papillons communs
Les papillons qui ont été étudiés ici sont des papillons relativement
répandus, que tout le monde peut croiser, comme l’azuré du serpolet, le
cuivré ou le fadet commun. On les trouve dans les livres grand public
et chacun peut les voir en se baladant.
En 2012, nous avons déjà relevé toute une série de menaces en
publiant la "liste rouge des papillons menacés en France". Et ce que
l’on observe, c’est que ce déclin des papillons dans les campagnes vaut
aussi pour d’autres espèces, comme les oiseaux communs.
Le premier problème, c’est l’agriculture intensive, telle qu’elle est
pratiquée en Europe et en France en particulier. Ce mode d’agriculture
se traduit par une uniformisation des paysages agricoles, avec de très
grands champs et la disparition des haies et des bosquets. Or, ces
habitats naturels sont importants pour un grand nombre d’espèces, dont
les insectes et les oiseaux.
D’autre part, l’agriculture intensive repose sur l’utilisation de
grandes quantités de pesticides, notamment en France qui est championne
en ce domaine. Et on ne peut pas utiliser autant d’herbicides, de
fongicides et d’insecticides sans faire des dégâts collatéraux sur
l’environnement, même chez les espèces qui ne sont pas visées par ces
produits.
Aujourd’hui, les villes apparaissent finalement comme des milieux
plus hospitaliers pour les espèces sauvages que les zones d’agriculture
intensive. À titre d’exemple, le suivi effectué par le Muséum national
d’histoire naturelle montre que les oiseaux communs ont régressé de 10%
en 20 ans en France, mais ce déclin atteint 20% dans les milieux
agricoles, pour des espèces comme le tarier des prés ou l’alouette des
champs.
Le second problème est, en quelque sorte, opposé au précédent. Dans certaines régions, notamment en moyenne montagne, c’est le recul de l'élevage pastoral qui menace les papillons.
L’élevage entretient des paysages ouverts de pairies, favorables aux
plantes nourricières dont dépendent les papillons. L’abandon des
pratiques agricoles pastorales entraîne un envahissement de ces milieux
par les broussailles et par la forêt, donc la disparition des pairies…
et des papillons qui y trouvent de quoi se nourrir.
Repenser notre agriculture
Cette nouvelle étude vient confirmer de nombreux résultats publiés
ces dernières années. Il est clair qu’il faut repenser notre manière de
cultiver. L’Union européenne a institué des zones agricoles dites "de
haute valeur environnementale", qu’elle encourage. Le principe est
d’inciter les exploitants agricoles à restaurer les haies, à laisser des
terrains en jachère et à utiliser moins de pesticides. C’est un pas
dans la bonne direction, bien sûr, mais le dispositif est encore loin
d’avoir fait ses preuves. Et les marges de progrès restent énormes vers
une réduction réelle des doses de pesticides ou l’encouragement de
l’agriculture biologique par exemple. Il faut désormais repenser
l’agriculture en Europe, pour qu’elle nourrisse la population et qu’elle
fasse vivre les agriculteurs, tout en préservant la richesse de la
biodiversité et la qualité de notre environnement.
On pourrait toujours choisir également de laisser ces espèces de
papillons disparaître, mais on ne sait pas par quelles espèces elles
seraient remplacées, ni même si elles le seraient, ni encore les
conséquences inévitables qu’aurait leur extinction sur les écosystèmes.
Ces animaux jouent un rôle dans leur environnement, leur disparition
serait une perte nette pour la biodiversité… et pour tous ceux qui les
apprécient.